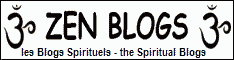- 310 -
attentif prouve qu'elle n'est ni la plus rationnelle ni la plus
vraisemblable, » à ceux-là surtout nous offrons la traduction ci-après,
que nous abrégeons, d'un article écrit le 27 juillet dernier, par M.
Lafayette R. Gridley, d'Attica (Indiana), aux éditeurs du Spiritual Age,
qui l'ont publié en entier dans leur feuille du 14 août.
Au mois de mai dernier, M. E. Rogers, de Cardington (Ohio), qui,
comme vous savez, est médium peintre et fait des portraits de personnes
qui ne sont plus de ce monde, vint passer quelques jours chez moi.
Pendant ce court séjour, il fut entransé par un artiste invisible qui se
donna pour Benjamin West, et il peignit quelques beaux portraits, de
grandeur naturelle, ainsi que d'autres moins satisfaisants.
Voici quelques particularités relatives à deux de ces portraits. Ils ont
été peints par ledit E. Rogers, dans une chambre obscure, chez moi, dans
le court intervalle d'une heure et trente minutes, dont une demi-heure
environ se passa sans que le médium fût influencé, et j'en profitai pour
examiner son travail, qui n'était pas encore achevé. Rogers fut entransé
de nouveau, et il termina ces portraits. Alors, et sans aucune indication
quant aux sujets ainsi représentés, l'un des portraits fut de suite reconnu
comme étant celui de mon grand-père, Elisha Gridley ; ma femme, ma
sœur, madame Chaney, et ensuite mon père et ma mère, tous furent
unanimes à trouver la ressemblance bonne : c'est un fac-similé du
vieillard, avec toutes les particularités de sa chevelure, de son col de
chemise, etc. Quant à l'autre portrait, aucun de nous ne le reconnaissant,
je le suspendis dans mon magasin, à la vue des passants, et il y resta une
semaine sans être reconnu de personne. Nous nous attendions à ce que
quelqu'un nous aurait dit qu'il représentait un ancien habitant d'Attica. Je
perdais l'espoir d'apprendre qui on avait voulu peindre, lorsqu'un soir,
ayant formé un cercle spiritualiste chez moi, un Esprit se manifesta et me
fit la communication que voici :
« Mon nom est Horace Gridley. Il y a plus de cinq ans que j'ai laissé
ma dépouille. J'ai demeuré plusieurs années à Natchez (Mississippi), où
j'ai occupé la place de shérif. Mon unique enfant demeure là. Je suis
cousin de votre père. Vous pouvez avoir d'autres renseignements sur
mon compte en vous adressant à votre oncle, M. Gridley, de Brownsville
(Tennessee). Le portrait que vous avez dans votre magasin est le mien, à
l'époque où je vivais sur terre, peu de temps avant de passer à cette autre
existence, plus élevée, plus heureuse et meilleure ; il me ressemble,
autant du moins que j'ai pu reprendre ma physionomie d'alors, car cela
est indispensable lorsqu'on nous peint, et nous le faisons le mieux que
nous pouvons nous en souvenir et suivant que les conditions du
moment le permettent. Le por-
- 311 -
trait en question n'est pas fini comme je l'aurais souhaité ; il y a quelques
légères imperfections que M. West dit provenir des conditions dans
lesquelles se trouvait le médium. Cependant, envoyez ce portrait à
Natchez, pour qu'on l'examine ; je crois qu'on le reconnaîtra. »
Les faits mentionnés dans cette communication étaient parfaitement
ignorés de moi, aussi bien que de tous les habitants de notre endroit. Une
fois cependant, il y a plusieurs années, j'avais entendu dire que mon père
avait eu un parent quelque part dans cette partie de la vallée du
Mississippi ; mais aucun de nous ne savait le nom de ce parent, ni
l'endroit où il avait vécu, ni même s'il était mort, et ce ne fut que
plusieurs jours ensuite que j'appris de mon père (qui habitait Delphi, à
quarante milles d'ici) quel avait été le lieu de résidence de son cousin,
dont il n'avait presque pas entendu parler depuis soixante ans. Nous
n'avions point songé à demander des portraits de famille ; j'avais
simplement posé devant le médium une note écrite contenant les noms
d'une vingtaine d'anciens habitants d'Attica, partis de ce monde, et nous
désirions obtenir le portrait de quelqu'un d'entre eux. Je pense donc que
tous les gens raisonnables admettront que le portrait ni la communication
d'Horace Gridley n'ont pu résulter d'une transmission de pensée de nous
au médium ; il est d'ailleurs certain que M. Rogers n'a jamais connu
aucun des deux hommes dont il a fait les portraits, et très probablement
il n'en avait jamais entendu parler, car il est Anglais de naissance ; il vint
en Amérique, il y a dix ans, et il n'est jamais allé plus sud que
Cincinnati, tandis qu'Horace Gridley, à ce que j'apprends, ne vint jamais
plus nord que Memphis (Tenn), dans les dernières trente ou trente-cinq
années de sa vie terrestre. J'ignore s'il visita jamais l'Angleterre ; mais ce
n'aurait pu être qu'avant la naissance de Rogers, car celui-ci n'a pas plus
de vingt-huit à trente ans. Quant à mon grand-père, mort depuis environ
dix-neuf ans, il n'était jamais sorti des Etats-Unis, et son portrait n'avait
jamais été fait d'aucune manière.
Dès que j'eus reçu la communication que j'ai transcrite plus haut,
j'écrivis à M. Gridley, de Brownsville, et sa réponse vint corroborer ce
que nous avait appris la communication de l'Esprit ; j'y trouvai en outre
le nom de l'unique enfant d'Horace Gridley, qui est madame L. M.
Patterson, habitant encore Natchez, où son père demeura longtemps, et
qui mourut, à ce que pense mon oncle, il y a environ six ans, à Houston
(Texas).
J'écrivis alors à Mme Patterson, ma cousine nouvellement découverte, et
lui envoyai une copie daguerréotypée du portrait que l'on nous disait être
celui de son père. Dans ma lettre à mon oncle, de Brownsville, je n'avais
rien dit de l'objet principal de mes recherches, et je n'en dis rien non plus
- 312 -
à Mme Patterson ; ni pourquoi j'envoyais ce portrait, ni comment je
l'avais eu, ni quelle était la personne qu'il représentait ; je demandai
simplement à ma cousine si elle y reconnaissait quelqu'un. Elle me
répondit qu'elle ne pouvait certainement pas dire de qui était ce portrait,
mais elle m'assurait qu'il ressemblait à son père à l'époque de sa mort.
Je lui écrivis ensuite que nous l'avions pris aussi pour le portrait de son
père, mais sans lui dire comment je l'avais eu. La réplique de ma cousine
portait, en substance, que dans l'ambrotype que je lui avais envoyé, ils
avaient tous reconnu son père, avant que je lui eusse dit que c'est lui qu'il
représente. Ma cousine témoigna beaucoup de surprise de ce que j'avais
un portrait de son père, lorsqu'elle même n'en avait jamais eu, et de ce
que son père ne lui eût jamais dit qu'il eût fait faire son portrait pour
n'importe qui. Elle n'avait pas cru qu'il en existât aucun. Elle se montra
bien satisfaite de mon envoi, surtout à cause de ses enfants, qui ont
beaucoup de vénération pour la mémoire de son père.
Alors je lui envoyai le portrait original, en l'autorisant à le garder, s'il
lui plaisait ; mais je ne lui dis pas encore comment je l'avais eu. Les
principaux passages de ce qu'elle m'écrivit en retour, sont les suivants :
« J'ai reçu votre lettre, ainsi que le portrait de mon père, que vous me
permettez de garder, s'il est assez ressemblant. Il l'est certainement
beaucoup ; et comme je n'ai jamais eu d'autre portrait de lui, je le garde,
puisque vous y consentez ; je l'accepte avec beaucoup de
reconnaissance, quoiqu'il me semble que mon père fût mieux que cela,
quand il se trouvait en bonne santé. »
Avant la réception des deux dernières lettres de madame Patterson, le
hasard voulut que M. Hedges, aujourd'hui de Delphi, mais autrefois de
Natchez, et M. Ewing, venu récemment de Vicksburg (Mississippi),
vissent le portrait en question et le reconnussent pour celui d'Horace
Gridley avec qui tous les deux avaient eu des relations.
Je trouve que ces faits ont trop de signification pour être passés sous
silence, et j'ai cru devoir vous les communiquer pour être publiés. Je
vous assure qu'en écrivant cet article j'ai bien pris garde que tout y soit
correct.
Remarque. Nous connaissons déjà les médiums dessinateurs ; outre les
remarquables dessins dont nous avons donné un spécimen, mais qui
nous retracent des choses dont nous ne pouvons vérifier l'exactitude,
nous avons vu exécuter sous nos yeux, par des médiums tout à fait
étrangers à cet art, des croquis très reconnaissables de personnes mortes
qu'ils n'avaient jamais connues ; mais de là à un portrait peint dans les
règles, il y a de la distance. Cette faculté se rattache à un phénomène fort
curieux dont nous sommes témoin en ce moment, et dont nous parlerons
prochainement.
- 313 -
Indépendance somnambulique.
Beaucoup de personnes, qui acceptent parfaitement aujourd'hui le
magnétisme, ont longtemps contesté la lucidité somnambulique ; c'est
qu'en effet cette faculté est venue dérouter toutes les notions que nous
avions sur la perception des choses du monde extérieur, et pourtant,
depuis longtemps on avait l'exemple des somnambules naturels, qui
jouissent de facultés analogues et que, par un contraste bizarre, on
n'avait jamais cherché à approfondir. Aujourd'hui, la clairvoyance
somnambulique est un fait acquis, et, s'il est encore contesté par
quelques personnes, c'est que les idées nouvelles sont longues à prendre
racine, surtout quand il faut renoncer à celles que l'on a longtemps
caressées ; c'est aussi que beaucoup de gens ont cru, comme on le fait
encore pour les manifestations spirites, que le somnambulisme pouvait
être expérimenté comme une machine, sans tenir compte des conditions
spéciales du phénomène ; c'est pourquoi n'ayant pas obtenu à leur gré, et
à point nommé, des résultats toujours satisfaisants, ils en ont conclu à la
négative. Des phénomènes aussi délicats exigent une observation
longue, assidue et persévérante, afin d'en saisir les nuances souvent
fugitives. C'est également par suite d'une observation incomplète des
faits que certaines personnes, tout en admettant la clairvoyance des
somnambules, contestent leur indépendance ; selon eux leur vue ne
s'étend pas au-delà de la pensée de celui qui les interroge ; quelques-uns
même prétendent qu'il n'y a pas vue, mais simplement intuition et
transmission de pensée, et ils citent des exemples à l'appui. Nul doute
que le somnambule voyant la pensée, peut quelquefois la traduire et en
être l'écho ; nous ne contestons même pas qu'elle ne puisse en certains
cas l'influencer : n'y aurait-il que cela dans le phénomène, ne serait-ce
pas déjà un fait bien curieux et bien digne d'observation ? La question
n'est donc pas de savoir si le somnambule est ou peut être influencé par
une pensée étrangère, cela n'est pas douteux, mais bien de savoir s'il est
toujours influencé : ceci est un résultat d'expérience. Si le somnambule
ne dit jamais que ce que vous savez, il est incontestable que c'est votre
pensée qu'il traduit ; mais si, dans certains cas, il dit ce que vous ne
savez pas, s'il contredit votre opinion, votre manière de voir, il est
évident qu'il est indépendant et ne suit que sa propre impulsion. Un seul
fait de ce genre bien caractérisé suffirait pour prouver que la sujétion du
somnambule à la pensée d'autrui n'est pas une chose absolue ; or il y en a
des milliers ; parmi ceux qui sont à notre connaissance personnelle, nous
citerons les deux suivants :
M. Marillon, demeurant à Bercy, rue de Charenton, n° 43, avait disparu
- 314 -
le 13 janvier dernier. Toutes les recherches pour découvrir ses traces
avaient été infructueuses, aucune des personnes chez lesquelles il avait
l'habitude d'aller ne l'avait vu ; aucune affaire ne pouvait motiver une
absence prolongée ; d'un autre côté, son caractère, sa position, son état
mental, écartaient toute idée de suicide. On en était réduit à penser qu'il
avait péri victime d'un crime ou d'un accident ; mais, dans cette dernière
hypothèse, il aurait pu être facilement reconnu et ramené à son domicile,
ou, tout au moins, porté à la Morgue. Toutes les probabilités étaient donc
pour le crime ; c'est à cette pensée que l'on s'arrêta, d'autant mieux qu'on
le croyait sorti pour aller faire un payement ; mais où et comment le
crime avait-il été commis ? c'est ce que l'on ignorait. Sa fille eut alors
recours à une somnambule, Mme Roger, qui en maintes autres
circonstances semblables avait donné des preuves d'une lucidité
remarquable que nous avons pu constater par nous-même. Mme Roger
suivit M. Marillon depuis sa sortie de chez lui, à 3 heures de l'aprèsmidi,
jusque vers 7 heures du soir, au moment où il se disposait à
rentrer ; elle le vit descendre ait bord de la Seine pour un motif pressant ;
là, dit-elle, il a eu une attaque d'apoplexie, je le vois tomber sur une
pierre, se faire une fente au front, puis couler dans l'eau ; ce n'est donc ni
un suicide ni un crime ; je vois encore son argent et une clef dans la
poche de son paletot. Elle indiqua l'endroit de l'accident ; mais, ajouta-telle,
ce n'est pas là qu'il est maintenant, il a été facilement entraîné par le
courant ; on le trouvera à tel endroit. C'est en effet ce qui eut lieu ; il
avait la blessure au front indiquée ; la clef et l'argent étaient dans sa
poche, et la position de ses vêtements indiquait suffisamment que la
somnambule ne s'était pas trompée sur le motif qui l'avait conduit au
bord de la rivière. Nous demandons où, dans tous ces détails, on peut
voir la transmission d'une pensée quelconque. Voici un autre fait où
l'indépendance somnambulique n'est pas moins évidente.
M. et Mme Belhomme, cultivateurs à Rueil, rue Saint-Denis, n° 19,
avaient en réserve une somme d'environ 8 à 900 francs. Pour plus de
sûreté, Mme Belhomme la plaça dans une armoire dont une partie était
consacrée au vieux linge, l'autre au linge neuf, c'est dans cette dernière
que l'argent fut placé ; à ce moment quelqu'un entra et Mme Belhomme
se hâta de refermer l'armoire. A quelque temps de là, ayant eu besoin
d'argent, elle se persuada l'avoir mis dans le vieux linge, parce que telle
avait été son intention, dans l'idée que le vieux tenterait moins les
voleurs ; mais, dans sa précipitation, à l'arrivée du visiteur, elle l'avait
mis dans l'autre case. Elle était tellement convaincue de l'avoir placé
dans le vieux linge, que l'idée de le chercher ailleurs ne lui vint même
pas ; trouvant la place vide, et se rappelant la visite, elle crut avoir été
remarquée et volée, et, dans cette
- 315 -
persuasion, ses soupçons se portaient naturellement sur le visiteur.
Mme Belhomme se trouvait connaître Mlle Marillon, dont nous avons
parlé plus haut, et lui conta sa mésaventure. Celle-ci lui ayant appris par
quel moyen son père avait été retrouvé, l'engagea à s'adresser à la même
somnambule, avant de faire aucune démarche. M. et Mme Belhomme se
rendirent donc chez Mme Roger, bien convaincus d'avoir été volés, et
dans l'espoir qu'on allait leur indiquer le voleur qui, dans leur opinion,
ne pouvait être que le visiteur. Telle était donc leur pensée exclusive ; or
la somnambule, après une description minutieuse de la localité, leur dit :
« Vous n'êtes pas volés ; votre argent est intact dans votre armoire,
seulement vous avez cru le mettre dans le vieux linge, tandis que vous
l'avez mis dans le neuf ; retournez chez vous et vous l'y trouverez. »
C'est en effet ce qui eut lieu.
Notre but, en rapportant ces deux faits, et nous pourrions en citer bien
d'autres tout aussi concluants, a été de prouver que la clairvoyance
somnambulique n'est pas toujours le reflet d'une pensée étrangère ; que
le somnambule peut ainsi avoir une lucidité propre, tout à fait
indépendante. Il en ressort des conséquences d'une haute gravité au point
de vue psychologique ; nous y trouvons la clef de plus d'un problème
que nous examinerons ultérieurement en traitant des rapports qui
existent entre le somnambulisme et le Spiritisme, rapports qui jettent un
jour tout nouveau sur la question.
_______
Une nuit oubliée ou la sorcière Manouza.
Mille deuxième nuit des Contes arabes,
Dictée par l'Esprit de Frédéric Soulié.
_______
PRÉFACE DE L'ÉDITEUR.
Dans le courant de l'année 1856, les expériences de manifestations
spirites que l'on faisait chez M. B…, rue Lamartine, y attiraient une
société nombreuse et choisie. Les Esprits qui se communiquaient dans ce
cercle étaient plus ou moins sérieux ; quelques-uns y ont dit des choses
admirables de sagesse, d'une profondeur remarquable, ce dont on peut
juger par le Livre des Esprits, qui y fut commencé et fait en très grande
partie. D'autres étaient moins graves ; leur humeur joviale se prêtait
volontiers à la plaisanterie, mais à une plaisanterie de bonne compagnie
et qui jamais ne s'est écartée des convenances. De ce nombre était
Frédéric Soulié, qui est venu de lui-même et sans y être convié, mais
dont les visites inattendues étaient toujours pour la société un passetemps
agréable. Sa conversation
- 316 -
était spirituelle, fine, mordante, pleine d'à-propos, et n'a jamais démenti
l'auteur des Mémoires du diable ; du reste, il ne s'est jamais flatté, et
quand on lui adressait quelques questions un peu ardues de philosophie,
il avouait franchement son insuffisance pour les résoudre, disant qu'il
était encore trop attaché à la matière, et qu'il préférait le gai au sérieux.
Le médium qui lui servait d'interprète était Mlle Caroline B..., l'une
des filles du maître de la maison, médium du genre exclusivement passif,
n'ayant jamais la moindre conscience de ce qu'elle écrivait, et pouvant
rire et causer à droite et à gauche, ce qu'elle faisait volontiers, pendant
que sa main marchait. Le moyen mécanique employé a été pendant fort
longtemps la corbeille-toupie décrite dans notre Livre des Médiums. Plus
tard le médium s'est servi de la psychographie directe.
On demandera sans doute quelle preuve nous avions que l'Esprit qui se
communiquait était celui de Frédéric Soulié plutôt que de tout autre. Ce
n'est point ici le cas de traiter la question de l'identité des Esprits ; nous
dirons seulement que celle de Soulié s'est révélée par ces mille
circonstances de détail qui ne peuvent échapper à une observation
attentive ; souvent un mot, une saillie, un fait personnel rapporté,
venaient nous confirmer que c'était bien lui ; il a plusieurs fois donné sa
signature, qui a été confrontée avec des originaux. Un jour on le pria de
donner son portrait, et le médium, qui ne sait pas dessiner, qui ne l'a
jamais vu, a tracé une esquisse d'une ressemblance frappante.
Personne, dans la réunion, n'avait eu des relations avec lui de son
vivant ; pourquoi donc y venait-il sans y être appelé ? C'est qu'il s'était
attaché à l'un des assistants sans jamais avoir voulu en dire le motif ; il
ne venait que quand cette personne était présente ; il entrait avec elle et
s'en allait avec elle ; de sorte que, quand elle n'y était pas, il n'y venait
pas non plus, et, chose bizarre, c'est que quand il était là, il était très
difficile, sinon impossible, d'avoir des communications avec d'autres
Esprits ; l'Esprit familier de la maison lui-même cédait la place, disant
que, par politesse, il devait faire les honneurs de chez lui.
Un jour, il annonça qu'il nous donnerait un roman de sa façon, et en
effet, quelque temps après, il commença un récit dont le début promettait
beaucoup ; le sujet était druidique et la scène se passait dans l'Armorique
au temps de la domination romaine ; malheureusement, il paraît qu'il fut
effrayé de la tâche qu'il avait entreprise, car, il faut bien le dire, un
travail assidu n'était pas son fort, et il avouait qu'il se complaisait plus
volontiers dans la paresse. Après quelques pages dictées, il laissa là son
roman, mais il annonça qu'il nous en écrirait un autre qui lui donnerait
moins de peine : c'est alors qu'il écrivit le conte dont nous commençons
la publication. Plus
- 317 -
A. K.
de trente personnes ont assisté à cette production et peuvent en attester
l'origine. Nous ne la donnons point comme une œuvre de haute portée
philosophique, mais comme un curieux échantillon d'un travail de
longue haleine obtenu des Esprits. On remarquera comme tout est suivi,
comme tout s'y enchaîne avec un art admirable. Ce qu'il y a de plus
extraordinaire, c'est que ce récit a été repris à cinq ou six fois différentes,
et souvent après des interruptions de deux ou trois semaines ; or, à
chaque reprise, le récit se suivait comme s'il eût été écrit tout d'un trait,
sans ratures, sans renvois et sans qu'on eût besoin de rappeler ce qui
avait précédé. Nous le donnons tel qu'il est sorti du crayon du médium,
sans avoir rien changé, ni au style, ni aux idées, ni à l'enchaînement des
faits. Quelques répétitions de mots et quelques petits péchés
d'orthographe avaient été signalés, Soulié nous a personnellement chargé
de les rectifier, disant qu'il nous assisterait en cela ; quand tout a été
terminé, il a voulu revoir l'ensemble, auquel il n'a fait que quelques
rectifications sans importance, et donné l'autorisation de le publier
comme on l'entendrait, faisant, dit-il, volontiers l'abandon de ses droits
d'auteur. Toutefois, nous n'avons pas cru devoir l'insérer dans notre
Revue sans le consentement formel de son ami posthume à qui il
appartenait de droit, puisque c'est à sa présence et à sa sollicitation que
nous étions redevable de cette production d'outre-tombe. Le titre a été
donné par l'Esprit de Frédéric Soulié lui-même.
_______
Une nuit oubliée.
I.
Il y avait, à Bagdad, une femme du temps d'Aladin ; c'est son histoire
que je vais te conter :
Dans un des faubourgs de Bagdad demeurait, non loin du palais de la
sultane Shéhérazad, une vieille femme nommée Manouza. Cette vieille
femme était un sujet de terreur pour toute la ville, car elle était sorcière
et des plus effrayantes. Il se passait la nuit, chez elle, des choses si
épouvantables que, sitôt le soleil couché, personne ne se serait hasardé à
passer devant sa demeure, à moins que ce ne fût un amant à la recherche
d'un philtre pour une maîtresse rebelle, ou une femme abandonnée en
quête d'un baume pour mettre sur la blessure que son amant lui avait
faite en la délaissant.
Un jour donc que le sultan était plus triste que d'habitude, et que la ville
était dans une grande désolation, parce qu'il voulait faire périr la sultane
favorite, et qu'à son exemple tous les maris étaient infidèles, un jeune homme
quitta une magnifique habitation située à côté du palais de la sultane. Ce
jeune homme portait une tunique et un turban de couleur sombre ;
- 318 -
mais sous ces simples habits il avait un grand air de distinction. Il
cherchait à se cacher le long des maisons comme un voleur ou un amant
craignant d'être surpris. Il dirigeait ses pas du côté de Manouza la
sorcière. Une vive anxiété était peinte sur ses traits, qui décelaient la
préoccupation dont il était agité. Il traversait les rues, les places avec
rapidité, et pourtant avec une grande précaution.
Arrivé près de la porte, il hésite quelques minutes, puis se décide à
frapper. Pendant un quart d'heure il eut de mortelles angoisses, car il
entendit des bruits que nulle oreille humaine n'avait encore entendus ;
une meute de chiens hurlant avec férocité, des cris lamentables, des
chants d'hommes et de femmes, comme à la fin d'une orgie, et, pour
éclairer tout ce tumulte, des lumières courant du haut en bas de la
maison, des feux follets de toutes les couleurs ; puis, comme par
enchantement, tout cessa : les lumières s'éteignirent et la porte s'ouvrit.
II.
Le visiteur resta un instant interdit, ne sachant s'il devait entrer dans le
couloir sombre qui s'offrait à sa vue. Enfin, s'armant de courage, il y
pénétra hardiment. Après avoir marché à tâtons l'espace de trente pas, il
se trouva en face d'une porte donnant dans une salle éclairée seulement
par une lampe de cuivre à trois becs, suspendue au milieu du plafond.
La maison qui, d'après le bruit qu'il avait entendu de la rue, semblait
devoir être très habitée, avait maintenant l'air désert ; cette salle qui était
immense, et devait par sa construction être la base de l'édifice, était vide,
si l'on en excepte les animaux empaillés de toutes sortes dont elle était
garnie.
Au milieu de cette salle était une petite table couverte de grimoires, et
devant cette table, dans un grand fauteuil, était assise une petite vieille,
haute à peine de deux coudées, et tellement emmitouflée de châles et de
turbans, qu'il était impossible de voir ses traits. A l'approche de
l'étranger, elle releva la tête et montra à ses yeux le plus effroyable
visage qu'il se peut imaginer.
« Te voilà, seigneur Noureddin, dit-elle en fixant ses yeux d'hyène
sur le jeune homme qui entrait ; approche ! Voilà plusieurs jours que
mon crocodile aux yeux de rubis m'a annoncé ta visite. Dis si c'est un
philtre qu'il te faut ; dis si c'est une fortune. Mais, que dis-je, une
fortune ! la tienne ne fait-elle pas envie au sultan lui-même ? N'es-tu
pas le plus riche comme tu es le plus beau ? C'est probablement un
philtre que tu viens chercher. Quelle est donc la femme qui ose t'être
cruelle ? Enfin je ne dois rien dire ;
- 319 -
je ne sais rien, je suis prête à écouter tes peines et à te donner les
remèdes nécessaires, si toutefois ma science a le pouvoir de t'être utile.
Mais que fais-tu donc là à me regarder ainsi sans avancer ? Aurais-tu
peur ? Je t'effraye peut-être ? Telle que tu me vois, j'étais belle autrefois ;
plus belle que toutes les femmes existantes aujourd'hui dans Bagdad ; ce
sont les chagrins qui m'ont rendue si laide. Mais que te font mes
souffrances ? Approche ; je t'écoute ; seulement je ne puis te donner que
dix minutes, ainsi dépêche-toi. »
Noureddin n'était pas très rassuré ; cependant, ne voulant pas montrer
aux yeux d'une vieille femme le trouble qui l'agitait, il s'avança et lui
dit : Femme, je viens pour une chose grave ; de ta réponse dépend le sort
de ma vie ; tu vas décider de mon bonheur ou de ma mort. Voici ce dont
il s'agit :
« Le sultan veut faire mourir Nazara ; je l'aime ; je vais te conter d'où
vient cet amour, et je viens te demander d'apporter un remède, non à ma
douleur, mais à sa malheureuse position, car je ne veux pas qu'elle
meure. Tu sais que mon palais est voisin de celui du sultan ; nos jardins
se touchent. Il y a environ six lunes qu'un soir, me promenant dans ces
jardins, j'entendis une charmante musique accompagnant la plus
délicieuse voix de femme qui se soit jamais entendue. Voulant savoir
d'où cela provenait, je m'approchai des jardins voisins, et je reconnus
que c'était d'un cabinet de verdure habité par la sultane favorite. Je restai
plusieurs jours absorbé par ces sons mélodieux ; nuit et jour je rêvais à la
belle inconnue dont la voix m'avait séduit ; car il faut te dire que, dans
ma pensée, elle ne pouvait être que belle. Je me promenais chaque soir
dans les mêmes allées où j'avais entendu cette ravissante harmonie ;
pendant cinq jours ce fut en vain ; enfin le sixième jour la musique se fit
entendre de nouveau ; alors n'y pouvant plus tenir, je m'approchai du
mur et je vis qu'il fallait peu d'efforts pour l'escalader.
« Après quelques moments d'hésitation, je pris un grand parti : je
passai de chez moi dans le jardin voisin ; là, je vis, non une femme, mais
une houri, la houri favorite de Mahomet, une merveille enfin ! A ma vue
elle s'effaroucha bien un peu, mais, me jetant à ses pieds, je la conjurai
de n'avoir aucune crainte et de m'écouter ; je lui dis que son chant
m'avait attiré et l'assurai qu'elle ne trouverait dans mes actions que le
plus profond respect ; elle eut la bonté de m'entendre.
« La première soirée se passa à parler de musique. Je chantais aussi, je lui
offris de l'accompagner ; elle y consentit, et nous nous donnâmes rendezvous
pour le lendemain à la même heure. A cette heure elle était plus
tranquille ; le sultan était à son conseil, et la surveillance moins grande. Les |
|